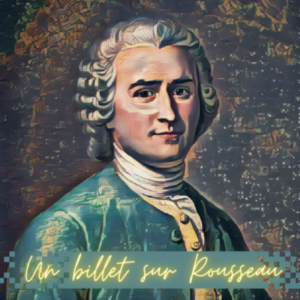
Il ne reste que quelques heures pour tenir les promesses de 2022, et quoi que la cuisine du réveillon m’appelle, je vais faire passer la charrette avant les vœux, et tenter, dans cette dernière ligne droite, la note de lecture que je t’ai promise sur Rousseau.
Pas tout Rousseau, hein ? Celle sur ce qui est décrit par un de ses éditeur comme la matrice de son œuvre morale et politique, celle où il affirme sa stature de philosophe, l’originalité de sa voix, la force de son système.
Pas moins. Ces lignes au sujet du Discours sur l’origine et les fondements des inégalités parmi les hommes peuvent paraître ronflonflon, je les ai découvertes exactes.
J’ai découvert dans ce discours un ton résolument moderne. Rousseau s’y adresse au lecteur. A ses lecteurs de l’époque, mais aussi à toi, à moi. Il y postule et y étaie une vision politique qui aujourd’hui encore nous rafraîchit. Il en décrit des possibles dérives à termes dont la justesse est stupéfiante.
Le Discours sur l’origine et les fondements des inégalités parmi les hommes – askip on dit le second Discours, pour le distinguer du Discours sur les sciences et les arts, paru en 1750 tandis que le second discours, donc, paraît en 1755 – est une réponse à une question posée à la ronde par l’Académie de Dijon, que voici :
Quelle est la source de l’inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle ?
Rousseau ouvre sa réponse sur des adresses au lecteur qui m’ont surprise par leur ton. Dans la version d’origine du second discours, celle qui s’adresse à l’académie, il interpelle ses juges en ces termes, qui peuvent paraître flatteurs : magnifiques, très honorés et souverains seigneurs, mais qu’il assigne toutefois à responsabilité : C’est de l’homme que j’ai à parler ; et la question que j’examine m’apprend que je vais parler à des hommes ; car on n’en propose point de semblables quand on craint d’honorer la vérité. Surtout, il ouvre son propos politique au conditionnel : si j’avais eu à choisir le lieu de ma naissance, j’aurai choisi… Ici, à mon avis, l’intention tout autant de souligner l’idéal politique que constitue pour lui la république de Genève que d’écarter, ailleurs, tout risque d’outrage et de censure. Ce conditionnel est repris à la fin du discours, dans un couplet dont je te régalerai plus tard.
Dans la version éditée que j’ai eue dans les mains, il s’adresse à toi, à moi, en ces mots :
J’ai ajouté quelques notes à cet ouvrage selon ma coutume paresseuse de travailler à bâtons rompus. Ces notes s’écartent quelques fois assez du sujet pour n’être pas bonnes à lire avec le texte. Je les ai donc rejetées à la fin du Discours, dans lequel j’ai tâché de suivre de mon mieux le plus droit chemin. Ceux qui auront le courage de recommencer pourront s’amuser la seconde fois à battre les buissons, et tenter de parcourir les notes ; il n’y aura pas de mal que les autres ne les lisent point du tout.
C’est peut-être la gratitude qui me chante aux oreilles la familiarité, mais la vérité ça m’a fait plaisir, que Rousseau accepte de m’accueillir dans son lectorat sans exiger de moi autre chose qu’une lecture d’agrément.
Et agréable, elle fut, cette lecture, dès les premières lignes de la préface, où tu te prends à regretter de ne jamais l’avoir eu à ta table à l’apéro. Extraits de la préface de sa réponse à une question qui, je le rappelle, se libelle :
Quelle est la source de l’inégalité parmi les hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle ?
Extraits choisis du préambule à la réponse du citoyen Rousseau (alerte divulgâchage) :
« Ayant eu le bonheur de naître parmi vous, comment pourrais-je méditer sur l’égalité que la nature a mise entre les hommes et sur l’inégalité qu’ils ont instituée »
Le propos est posé.
« Si j’avais eu à choisir le lieu de ma naissance, j’aurais choisi une société d’une grandeur bornée par l’étendue des facultés humaines, c’est-à-dire par la possibilité d’être bien gouvernée, et où, chacun suffisant à son emploi, nul n’eût été contraint de commettre à d’autres les fonctions dont il était chargé. »
Soupir d’aise.
« J’aurais donc voulu que personne dans l’état n’eût pu se dire au-dessus de la loi, et que personne au-dehors n’en pût imposer que l’état fût obligé de reconnaître ; car, quelle que puisse être la constitution d’un gouvernement, s’il s’y trouve un seul homme qui ne soit pas soumis à la loi, tous les autres sont nécessairement à la discrétion de celui-là. »
Rends la bebar girly.
Bon, on reste en 1755, et on relit aussi la trace de ce qui structure la pensée conservatrice un peu plus bas, mais sans rancune car on aurait aimé trouver les mots au moment du vote de la loi sécurité globale.
« c’est surtout la grande antiquité des lois qui les rend saintes et vénérables ; que le peuple méprise bientôt celles qu’il voit changer tous les jours, et qu’en s’accoutumant à négliger les anciens usages, sous prétexte de faire mieux, on introduit souvent de grands maux pour en corriger de moindres. »
Ce bouquet de paillettes étant lancé, je comprends la structure de sa réponse comme suit :
Etablir l’origine de l’inégalité parmi les hommes exige de remonter à l’origine de l’homme. Or comment connaître l’homme alors que la nature et les circonstances ont modifié son état primitif ? Dans cet extrait du développement, tu noteras comment Rousseau attache un propos politique jubilatoire à une réponse académique.
« Les philosophes qui ont examiné les fondements de la société ont tous senti la nécessité de remonter jusqu’à l’état de nature, mais aucun d’eux n’y est arrivé. Les uns n’ont point balancé à supposer à l’homme dans cet état la notion du juste et de l’injuste, sans se soucier de montrer qu’il dût avoir cette notion, ni même qu’elle lui fût utile. D’autres ont parlé du droit naturel que chacun a de conserver ce qui lui appartient, sans expliquer ce qu’ils entendaient par appartenir. D’autres, donnant d’abord au plus fort l’autorité sur le plus faible, ont aussitôt fait naître le gouvernement, sans songer au temps qui dut s’écouler avant que le sens des mots d’autorité et de gouvernement pût exister parmi les hommes. Enfin tous, parlant sans cesse de besoin, d’avidité, d’oppression, de désirs, et d’orgueil, ont transporté à l’état de nature des idées qu’ils avaient prises dans la société : ils parlaient de l’homme sauvage, et ils peignaient l’homme civil. »
Si on s’attache à examiner, d’après le discours, les évènements qui ont conduit à l’émergence de l’inégalité, on distinguera trois étapes :
Primo, le moment où le langage permet la notion morale
Secundo, le moment où l’enclos permet la notion de propriété
Tertio, le moment où l’industrie légitime la notion de pouvoir
Partons sur prime. J’ai retenu de l’analyse historique de l’émergence du langage que propose Rousseau l’histoire des hasards.
« Combien de siècles se sont peut-être écoulés, avant que les hommes aient été à portée de voir d’autre feu que celui du ciel ? Combien ne leur a-t-il pas fallu de différents hasards pour apprendre les usages les plus communs de cet élément ? Combien de fois ne l’ont-ils pas laissé éteindre, avant que d’avoir acquis l’art de le reproduire ? Et combien de fois peut-être chacun de ces secrets n’est-il pas mort avec celui qui l’avait découvert ?
Qu’on songe de combien d’idées nous sommes redevables à l’usage de la parole ; combien la grammaire exerce et facilite les opérations de l’esprit ; et qu’on pense aux peines inconcevables, et au temps infini qu’a dû coûter la première invention des langues ; qu’on joigne ces réflexions aux précédentes, et l’on jugera combien il eût fallu de milliers de siècles, pour développer successivement dans l’esprit humain les opérations dont il était capable. »
A sa suite, l’histoire du cri
« Le premier langage de l’homme, le langage le plus universel, le plus énergique, et le seul dont il eut besoin, avant qu’il fallût persuader des hommes assemblés, est le cri de la nature. Comme ce cri n’était arraché que par une sorte d’instinct dans les occasions pressantes, pour implorer du secours dans les grands dangers, ou du soulagement dans les maux violents, il n’était pas d’un grand usage dans le cours ordinaire de la vie, où règnent des sentiments plus modérés. »
Combinant l’un et l’autre, la façon dont les climats forgèrent des langues en commun, dans une intelligence collective inégalée.
« On doit juger que les premiers mots, dont les hommes firent usage, eurent dans leur esprit une signification beaucoup plus étendue que n’ont ceux qu’on emploie dans les langues déjà formées, et qu’ignorant la division du discours en ses parties constitutives, ils donnèrent d’abord à chaque mot le sens d’une proposition entière. Quand ils commencèrent à distinguer le sujet d’avec l’attribut, et le verbe d’avec le nom, ce qui ne fut pas un médiocre effort de génie, les substantifs ne furent d’abord qu’autant de noms propres.
Quant aux classes primitives et aux notions les plus générales, il est superflu d’ajouter qu’elles durent leur échapper encore : comment, par exemple, auraient-ils imaginé ou entendu les mots de matière, d’esprit, de substance, de mode, de figure, de mouvement, puisque nos philosophes qui s’en servent depuis si longtemps ont bien de la peine à les entendre eux-mêmes, et que les idées qu’on attache à ces mots étant purement métaphysiques, ils n’en trouvaient aucun modèle dans la nature ? »
Il imagine ici ce qu’il a fallu de temps et de connaissances pour trouver les nombres, les mots abstraits, les aoristes, et tous les temps des verbes, les particules, la syntaxe, lier les propositions, les raisonnements, et former toute la logique du discours.
Et c’est à ce moment du discours que revient la familiarité, avec ce tout premier « low-kick balayette » :
J’entends toujours répéter que les plus forts opprimeront les faibles ; mais qu’on m’explique ce qu’on veut dire par ce mot d’oppression. […] je ne vois pas comment cela pourrait se dire des hommes sauvages, à qui l’on aurait même bien de la peine à faire entendre ce que c’est que servitude et domination. Un homme pourra bien s’emparer des fruits qu’un autre a cueillis, du gibier qu’il a tué, de l’antre qui lui servait l’asile ; mais comment viendra-t-il jamais à bout de s’en faire obéir, et quelles pourront être les chaînes de la dépendance parmi des hommes qui ne possèdent rien ?
Ippon, les deux épaules touchent par terre. Non seulement la notion d’inégalité naturelle implose, mais on voit poindre un propos auquel je ne m’attendais pas : l’illégitimité de la domination.
Mais revenons au développement, avec, secundo, la fonction de l’enclos.
« Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n’est à personne ! »
Moi non plus, j’étais pas prête. Cent ans avant Marx. Bim, la propriété. Et re-bim sur la sobriété, plus bas :
« Dans ce nouvel état, avec une vie simple et solitaire, des besoins très bornés, et les instruments qu’ils avaient inventés pour y pourvoir, les hommes jouissant d’un fort grand loisir l’employèrent à se procurer plusieurs sortes de commodités inconnues à leurs pères ; et ce fut là le premier joug qu’ils s’imposèrent sans y songer, et la première source de maux qu’ils préparèrent à leurs descendants ; car outre qu’ils continuèrent ainsi à s’amollir le corps et l’esprit, ces commodités ayant par l’habitude perdu presque tout leur agrément, et étant en même temps dégénérées en de vrais besoins, la privation en devint beaucoup plus cruelle que la possession n’en était douce, et l’on était malheureux de les perdre, sans être heureux de les posséder. »
Malheureux de les perdre sans être heureux de les posséder. On retrouvera plus bas cette contemption du superflu, du frivole. Pourtant, Rousseau reconnaît à la goguette sa fonction dans la création sociale, pour le meilleur comme pour le pire.
« On s’accoutuma à s’assembler devant les cabanes ou autour d’un grand arbre : le chant et la danse, vrais enfants de l’amour et du loisir, devinrent l’amusement ou plutôt l’occupation des hommes et des femmes oisifs et attroupés. Chacun commença à regarder les autres et à vouloir être regardé soi-même, et l’estime publique eut un prix. Celui qui chantait ou dansait le mieux ; le plus beau, le plus fort, le plus adroit ou le plus éloquent devint le plus considéré, et ce fut là le premier pas vers l’inégalité, et vers le vice en même temps : de ces premières préférences naquirent d’un côté la vanité et le mépris, de l’autre la honte et l’envie ; et la fermentation causée par ces nouveaux levains produisit enfin des composés funestes au bonheur et à l’innocence. »
Nous voici équipé.es des mots et des émotions propres à la comparaison. Et l’heure sonne de s’ordonnancer avec, tercio, le pouvoir, point qu’il amène dès la conclusion de la première partie en ces termes :
« Les liens de la servitude n’étant formés que de la dépendance mutuelle des hommes et des besoins réciproques qui les unissent, il est impossible d’asservir un homme sans l’avoir mis auparavant dans le cas de ne pouvoir se passer d’un autre ; situation qui n’existant pas dans l’état de nature, y laisse chacun libre du joug et rend vaine la loi du plus fort. »
Ici, il reprend :
« Tant que les hommes se contentèrent de leurs cabanes rustiques, tant qu’ils se bornèrent à coudre leurs habits de peaux avec des épines ou des arêtes, à se parer de plumes et de coquillages, à se peindre le corps de diverses couleurs, à perfectionner ou à embellir leurs arcs et leurs flèches, à tailler avec des pierres tranchantes quelques canots de pêcheurs ou quelques grossiers instruments de musique, en un mot tant qu’ils ne s’appliquèrent qu’à des ouvrages qu’un seul pouvait faire, et qu’à des arts qui n’avaient pas besoin du concours de plusieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons et heureux autant qu’ils pouvaient l’être par leur nature, et continuèrent à jouir entre eux des douceurs d’un commerce indépendant : mais dès l’instant qu’un homme eut besoin du secours d’un autre ; dès qu’on s’aperçut qu’il était utile à un seul d’avoir des provisions pour deux, l’égalité disparut, la propriété s’introduisit, le travail devint nécessaire et les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes qu’il fallut arroser de la sueur des hommes, et dans lesquelles on vit bientôt l’esclavage et la misère germer et croître avec les moissons. »
Arroser de la sueur des hommes. Il nous manque, Jean-Jacques, à l’heure de penser la décroissance.
« Quand les héritages se furent accrus en nombre et en étendue au point de couvrir le sol entier et de se toucher tous, les uns ne purent plus s’agrandir qu’aux dépens des autres, et les surnuméraires que la faiblesse ou l’indolence avaient empêchés d’en acquérir à leur tour, devenus pauvres sans avoir rien perdu, parce que, tout changeant autour d’eux, eux seuls n’avaient point changé, furent obligés de recevoir ou de ravir leur subsistance de la main des riches, et de là commencèrent à naître, selon les divers caractères des uns et des autres, la domination et la servitude, ou la violence et les rapines. »
Ce qui me frappe dans ces lignes, c’est la façon dont Rousseau étire la logique de l’homme originel. Celui qui seul n’avait point changé, et, devenu pauvre, fut obligé de. Le principe de nécessité avant l’heure, en somme. Mais la clarté du propos ne s’arrête pas là.
« Quelque couleur [que les riches] pussent donner à leurs usurpations, ils sentaient assez qu’elles n’étaient établies que sur un droit précaire et abusif et que n’ayant été acquises que par la force, la force pouvait les leur ôter sans qu’ils eussent raison de s’en plaindre. Ils avaient beau dire : C’est moi qui ai bâti ce mur ; j’ai gagné ce terrain par mon travail. Qui vous a donné les alignements, leur pouvait-on répondre, et en vertu de quoi prétendez-vous être payé à nos dépens d’un travail que nous ne vous avons point imposé ? Ignorez-vous qu’une multitude de vos frères périt, ou souffre du besoin de ce que vous avez de trop, et qu’il vous fallait un consentement exprès et unanime du genre humain pour vous approprier sur la subsistance commune tout ce qui allait au-delà de la vôtre ? »
Eat the rich dans le texte. Eat the rich before they make a slave of you. Comme le démontre la partie suivante sur la constitution des gouvernements :
« Il en fallut beaucoup moins que l’équivalent de ce discours pour entraîner des hommes grossiers, faciles à séduire, qui d’ailleurs avaient trop d’affaires à démêler entre eux pour pouvoir se passer d’arbitres, et trop d’avarice et d’ambition, pour pouvoir longtemps se passer de maîtres. Tous coururent au-devant de leurs fers croyant assurer leur liberté ; car avec assez de raison pour sentir les avantages d’un établissement politique, ils n’avaient pas assez d’expérience pour en prévoir les dangers ; les plus capables de pressentir les abus étaient précisément ceux qui comptaient d’en profiter, et les sages mêmes virent qu’il fallait se résoudre à sacrifier une partie de leur liberté à la conservation de l’autre, comme un blessé se fait couper le bras pour sauver le reste du corps. Telle fut, ou dut être, l’origine de la société et des lois, qui donnèrent de nouvelles entraves au faible et de nouvelles forces au riche, détruisirent sans retour la liberté naturelle, fixèrent pour jamais la loi de la propriété et de l’inégalité, d’une adroite usurpation firent un droit irrévocable, et pour le profit de quelques ambitieux assujettirent désormais tout le genre humain au travail, à la servitude et à la misère. »
Fixèrent à jamais la loi de la propriété et de l’inégalité. J’en reviens tout juste. Et à quelques encâblures, on voit arriver les clauses du futur contrat social.
« En continuant d’examiner ainsi les faits par le droit, on ne trouverait pas plus de solidité que de vérité dans l’établissement volontaire de la tyrannie, et il serait difficile de montrer la validité d’un contrat qui n’obligerait qu’une des parties, où l’on mettrait tout d’un côté et rien de l’autre et qui ne tournerait qu’au préjudice de celui qui s’engage. »
« Or, à ne considérer, comme nous faisons, que l’institution humaine, si le magistrat qui a tout le pouvoir en main et qui s’approprie tous les avantages du contrat, avait pourtant le droit de renoncer à l’autorité ; à plus forte raison le peuple, qui paye toutes les fautes des chefs, devrait avoir le droit de renoncer à la dépendance. »
Or Rousseau souligne combien les droits de la seconde partie au contrat ont été élimés, et comment, à la faveur des crises liées aux périodes électorales « L’ambition des principaux (gouvernants) profita de ces circonstances pour perpétuer leurs charges dans leurs familles : le peuple déjà accoutumé à la dépendance, au repos et aux commodités de la vie, et déjà hors d’état de briser ses fers, consentit à laisser augmenter sa servitude pour affermir sa tranquillité. »
Le voici arrivé à sa conclusion préliminaire
« Si nous suivons le progrès de l’inégalité dans ces différentes révolutions, nous trouverons que l’établissement de la loi et du droit de propriété fut son premier terme ; l’institution de la magistrature le second, que le troisième et dernier fut le changement du pouvoir légitime en pouvoir arbitraire ; en sorte que l’état de riche et de pauvre fut autorisé par la première époque, celui de puissant et de faible par la seconde, et par la troisième celui de maître et d’esclave, qui est le dernier degré de l’inégalité, et le terme auquel aboutissent enfin tous les autres, jusqu’à ce que de nouvelles révolutions dissolvent tout à fait le gouvernement, ou le rapprochent de l’institution légitime. »
Le second low-kick balayette est en réalité une série d’hypothèses exprimées au conditionnel. Elles s’appuient sur une catégorisation des sources de la domination des uns par les autres qui se propose comme suit :
« Si c’était ici le lieu d’entrer en des détails, j’expliquerais facilement comment l’inégalité de crédit et d’autorité devient inévitable entre les particuliers sitôt que réunis en une même société ils sont forcés de se comparer entre eux et de tenir compte des différences qu’ils trouvent dans l’usage continuel qu’ils ont à faire les uns des autres.
Ces différences sont de plusieurs espèces, mais en général la richesse, la noblesse ou le rang, la puissance et le mérite personnel. »
Cette catégorisation étaie une vision du monde qui vaut aujourd’hui tout autant qu’en 1755. Ça m’a presque flippée.
« Je ferais voir qu’entre ces quatre sortes d’inégalité, les qualités personnelles étant l’origine de toutes les autres, la richesse est la dernière à laquelle elles se réduisent à la fin, parce qu’étant la plus immédiatement utile au bien-être et la plus facile à communiquer, on s’en sert aisément pour acheter tout le reste.
Je remarquerais combien ce désir universel de réputation, d’honneurs et de préférences, qui nous dévore tous, exerce et compare les talents et les forces, combien il excite et multiplie les passions.
Je montrerais que c’est à cette ardeur de faire parler de soi, à cette fureur de se distinguer qui nous tient presque toujours hors de nous-mêmes, que nous devons ce qu’il y a de meilleur et de pire parmi les hommes.
Je prouverais enfin que si l’on voit une poignée de puissants et de riches au faîte des grandeurs et de la fortune, tandis que la foule rampe dans l’obscurité et dans la misère, c’est que les premiers n’estiment les choses dont ils jouissent qu’autant que les autres en sont privés, et que, sans changer d’état, ils cesseraient d’être heureux, si le peuple cessait d’être misérable. »
Un peu plus loin, il résume cette perspective en peu de mots :
« Telle est, en effet, la véritable cause de toutes ces différences : le sauvage vit en lui-même ; l’homme sociable toujours hors de lui ne fait vivre que dans l’opinion des autres, et c’est, pour ainsi dire, de leur seul jugement qu’il tire le sentiment de sa propre existence. »
Enfin, Rousseau égrène sur les dérives possibles des sociétés politiques une série d’intuitions stupéfiantes de justesse aujourd’hui, en listant : toutes les faces différentes sous lesquelles l’inégalité pourra se montrer dans les siècles selon la nature de ces gouvernements et les révolutions que le temps y amènera nécessairement.
Cette liste est exprimée là encore au conditionnel, car il s’agit de ce que contiendrait, si le temps de l’écrire lui en était donné, l’ouvrage considérable dans lequel on pèserait les avantages et les inconvénients de tout gouvernement :
« On verrait la multitude opprimée au-dedans par une suite des précautions mêmes qu’elle avait prises contre ce qui la menaçait au-dehors. »
Sécurité globale.
« On verrait l’oppression s’accroître continuellement sans que les opprimés pussent jamais savoir quel terme elle aurait, ni quels moyens légitimes il leur resterait pour l’arrêter. »
Budget de la justice.
« On verrait les droits des citoyens et les libertés nationales s’éteindre peu à peu, et les réclamations des faibles traitées de murmures séditieux. »
Séparatisme.
« On verrait la politique restreindre à une portion mercenaire du peuple l’honneur de défendre la cause commune. »
Violences policières.
« De l’extrême inégalité des conditions et des fortunes, de la diversité des passions et des talents, des arts inutiles, des arts pernicieux, des sciences frivoles sortiraient des foules de préjugés, également contraires à la raison, au bonheur et à la vertu. »
Société de consommation et d’information frivole.
« On verrait fomenter par les chefs tout ce qui peut affaiblir des hommes rassemblés en les désunissant ; tout ce qui peut donner à la société un air de concorde apparente et y semer un germe de division réelle ; tout ce qui peut inspirer aux différents ordres une défiance et une haine mutuelle par l’opposition de leurs droits et de leurs intérêts, et fortifier par conséquent le pouvoir qui les contient tous. »
Grande galerie de l’évolution des nuisibles. (je m’autocite, c’est l’émotion).
« C’est du sein de ce désordre et de ces révolutions que le despotisme, élevant par degrés sa tête hideuse et dévorant tout ce qu’il aurait aperçu de bon et de sain dans toutes les parties de l’État, parviendrait enfin à fouler aux pieds les lois et le peuple, et à s’établir sur les ruines de la république.
C’est ici le dernier terme de l’inégalité, et le point extrême qui ferme le cercle et touche au point d’où nous sommes partis. C’est ici que tous les particuliers redeviennent égaux parce qu’ils ne sont rien.
C’est ici que tout se ramène à la seule loi du plus fort et par conséquent à un nouvel état de nature différent de celui par lequel nous avons commencé, en ce que l’un était l’état de nature dans sa pureté, et que ce dernier est le fruit d’un excès de corruption. Il y a si peu de différence d’ailleurs entre ces deux états et le contrat de gouvernement est tellement dissous par le despotisme que le despote n’est le maître qu’aussi longtemps qu’il est le plus fort et que, sitôt qu’on peut l’expulser, il n’a point à réclamer contre la violence. »
Bruit blanc.
« J’ai tâché d’exposer l’origine et le progrès de l’inégalité, l’établissement et l’abus des sociétés politiques. Il suit de cet exposé que l’inégalité, étant presque nulle dans l’état de nature, tire sa force et son accroissement du développement de nos facultés et des progrès de l’esprit humain et devient enfin stable et légitime par l’établissement de la propriété et des lois. Il suit encore que l’inégalité morale, autorisée par le seul droit positif, est contraire au droit naturel, toutes les fois qu’elle ne concourt pas en même proportion avec l’inégalité physique ; distinction qui détermine suffisamment ce qu’on doit penser à cet égard de la sorte d’inégalité qui règne parmi tous les peuples policés ; puisqu’il est manifestement contre la Loi de Nature, de quelque manière qu’on la définisse, qu’un enfant commande à un vieillard, qu’un imbécile conduise un homme sage, et qu’une poignée de gens regorge de superfluités, tandis que la multitude affamée manque du nécessaire. »
Lire et relire Rousseau et ce second discours, dans l’époque que nous traversons, c’est rallumer la lumière. C’est ressentir fort fort combien notre intuition de ce qui rendra demain désirable a animé les siècles. Combien elle était là avant nous. Combien elle nous survivra.